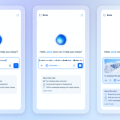La loi de 2000 adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a révolutionné notre Code civil (1). Avec l’intensification des échanges électroniques et des projets de dématérialisation, la signature électronique « pour tous » est en fort développement. Difficile, compliquée ? Non, la signature électronique est simple et vise tout le monde, l’essayer, c’est l’adopter !
La loi de 2000 adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a révolutionné notre Code civil (1). Avec l’intensification des échanges électroniques et des projets de dématérialisation, la signature électronique « pour tous » est en fort développement. Difficile, compliquée ? Non, la signature électronique est simple et vise tout le monde, l’essayer, c’est l’adopter !
1- dessine-moi une signature électronique « juridique »
1- qu’est-ce qu’une signature en droit ?
Paraphe, autographe, signature manuscrite, signature électronique, est-ce la même chose ? On retrouve généralement la signature dans deux domaines : l’art et le droit. Dans le domaine de l’art, la signature est le sceau de l’origine d’une œuvre, la garantie de son authenticité, et sert le plus souvent à définir son prix.
En droit, la fonction de la signature est similaire. C’est l’article 1316-4 alinéa 1 qui en donne la définition : « La signature nécessaire à la...
Cet article vous intéresse? Retrouvez-le en intégralité dans le magazine Archimag !
�